8 mars
Journée internationale des droits des femmes
Origine
Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs droits et réclamer le droit de vote.
La création d’une Journée internationale des femmes a été proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrivait alors dans une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, et en France en 1982.
"Les suffragettes"
Quelques dates importantes en France
1850 : création d’écoles primaires pour filles
1861 : JulieVictoire Daubié : première bachelière
1863 : création de cours secondaires pour filles
1900 : Jeanne Chauvin première femme avocate.
1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de Physique
1908 : Madeleine Brès, première femme à exercer la médecine
1936 : le gouvernement Léon Blum compte 3 femmes sous-secrétaires d'état
1941 : officialisation de la fête des mères
1944 : droit de vote
1945 : 34 femmes sont élues députées
1980 Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française
««««««
Quelques exemples de femmes pionnières dans leurs domaines respectifs :
LOUISE WEISS
1893-1983
Grand-mère de l’Europe
![Louise Weiss[1]](http://img.over-blog.com/300x218/1/83/07/63/femmes/Louise_Weiss-1-.jpg)
Louise Weiss parmi les féministes en 1935
Louise Weiss, née le 25 avril 1893 à Arras, agrégée de lettres à 21 ans, féministe, européenne convaincue, pacifiste, fut aussi une militante du droit de vote pour les femmes.
Femme de convictions et marquée par l’horreur du premier conflit mondial, elle chercha à rapprocher la France et l’Allemagne ; elle fonda et dirigea notamment la revue L’Europe nouvelle entre 1920 et 1934. Elle fit partie de l’entourage d’Aristide Briand qu’elle avait rencontré à Genève lorsque celui-ci obtint l’adhésion de l’Allemagne à la Société des Nations.
![weiss bertin[1]](http://img.over-blog.com/189x300/1/83/07/63/femmes/weiss_bertin-1-.jpg)
En 1936, elle s’engagea dans le combat féministe et devint militante pour le vote des Françaises ; elle mena des actions spectaculaires destinées à attirer l’attention de la presse. Elle fonda l’association « La Femme nouvelle » qui a compté plusieurs milliers d’adhérentes. En 1936, elle refusa un poste ministériel proposé par Léon Blum en répondant « J’ai lutté pour être élue, pas pour être nommée »
En 1945, avec Gaston Bouthoul, fondateur de la polémologie (science de la compréhension des conflits) elle fonda l’Institut de polémologie et parcourut le monde réalisant films et documentaires au service de la paix.
En 1979, à 86 ans, elle prononça un discours d’ouverture historique lors de la première session du nouveau parlement à Strasbourg.
Elle fut élevée à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur en 1976, troisième femme seulement à recevoir ce grade dans cet ordre.
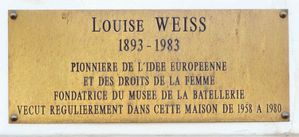
««««««
MARTHE SIMARD
1901-1993
Première parlementaire

Marthe Simard, née Marthe Caillaud, le 6 avril 1901 en Algérie est décédée à Québec le 28 mars 1993 où elle vivait avec son mari, le Docteur Simard, franco-québécois.
Fondatrice en décembre 1940 du Comité France Libre de Québec, elle fut la première femme française à avoir siégé dans une assemblée parlementaire.
L’ordonnance du 17 septembre 1943 crée, à Alger, l’Assemblée consultative provisoire. Ses membres ne sont pas élus, mais choisis. Parmi eux, pour la première fois, siège une femme Marthe Simard, nommée le 20 octobre 1943, après avoir été désignée par les représentants des mouvements de la Résistance extérieure pour y représenter le Canada..
En novembre 1944, l’Assemblée quitte Alger pour Paris, Marthe Simard est alors l’une des 10 femmes parlementaires aux côtés, notamment de Lucie Aubrac, Gilberte Brossolette, Andrée Viénot.
Sur proposition d’André Malraux, elle est promue Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur dès la première promotion « Victoire » du 3 mai 1946
Source : Ces femmes qui ont réveillé la France de J-L Debré
««««««
MARIE-ANGELIQUE DUCHEMIN-BRULON
1772-1859
Marie-Angélique Duchemin, née le 20 janvier 1772 à Dinan et morte le 13 juillet 1859 à Paris, est la première femme à avoir été décorée de la Légion d’Honneur.
A 17 ans elle épousa le caporal André Brulon et, comme de nombreuses femmes à cette époque, elle suivit l’armée en campagne. A la mort de son mari et de son père en 1792, elle décida de s’engager.
Elle fut rapidement promue caporal fourrier puis sergent –major grâce à son autorité et à sa bravoure au combat, comme au siège de Calvi en août 1794.
Lors de ce siège, elle fut grièvement blessée et, ses blessures mal soignées la poussèrent, en 1797, à déposer une demande d’entrée à l’Hôtel des Invalides où elle ne fut acceptée que 7 ans plus tard. Elle fut la première femme à être admise à l’Hôtel des Invalides avec le grade de sous-lieutenant. Elle y resta toute sa vie, prenant diverses responsabilités comme gérante du magasin d’habillement, jusqu’à sa mort en 1859. Elle reçut la visite de nombreuses personnalités politiques et militaires mais refusa systématiquement de voir Napoléon qu’elle accusait d’être responsable de la mort de son mari.
Sous la Restauration, elle reçut l’épaulette d’officier, et le 15 août 1851, ( Marie-Angélique Brulon était alors âgée de 79 ans) Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République lui remit la croix de la Légion d’Honneur avec le titre de Chevalier.
Source : Les Vétérans de Napoléon 1er
![images[4]](http://img.over-blog.com/300x283/1/83/07/63/activites-2012/fete-des-peres/images-4-.jpg)
![sonora louise smart dodd[1]](http://img.over-blog.com/233x300/1/83/07/63/activites-2012/fete-des-peres/sonora_louise_smart_dodd-1-.jpg)
![2553-Petit%20guitariste%20bonne%20fete%20papa mini[1]](http://img.over-blog.com/215x300/1/83/07/63/activites-2012/fete-des-peres/2553-Petit-20guitariste-20bonne-20fete-20papa_mini-1-.gif)
![7abd587c344c69bd4586b2ff6f54fade[1]](http://img.over-blog.com/224x300/1/83/07/63/activites-2012/fete-des-peres/7abd587c344c69bd4586b2ff6f54fade-1-.jpg)




![carte postale ancienne muguet[2]](http://img.over-blog.com/300x189/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/carte-postale-ancienne-muguet-2-.jpg)
![conservez moi porte bonheur 02[1]](http://img.over-blog.com/300x193/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/conservez_moi_porte_bonheur_02-1-.jpg)
![1727721388 small[1]](http://img.over-blog.com/189x300/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/1727721388_small-1-.jpg)
![4aca19fc[1]](http://img.over-blog.com/185x300/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/4aca19fc-1-.jpg)
![muguet[1]](http://img.over-blog.com/202x300/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/muguet-1-.jpg)
![avril1[1]](http://img.over-blog.com/300x188/1/83/07/63/cartes-fantaisies/avril1-1-.jpg)
![carte-poisson-avril[1]](http://img.over-blog.com/300x193/1/83/07/63/cartes-fantaisies/carte-poisson-avril-1-.jpg)
![db5d26c8[1]](http://img.over-blog.com/300x193/1/83/07/63/cartes-fantaisies/db5d26c8-1-.jpg)
![Cartes postales poissons d'avril[1]](http://img.over-blog.com/300x221/1/83/07/63/cartes-fantaisies/Cartes_postales_poissons_d-avril-1-.jpg)
![1811701[1]](http://img.over-blog.com/240x300/1/83/07/63/cartes-fantaisies/1811701-1-.jpg)
![images[4]](http://img.over-blog.com/262x300/1/83/07/63/femmes/images-4-.jpg)
![images[2]](http://img.over-blog.com/300x173/1/83/07/63/femmes/images-2-.jpg)
![images[3]](http://img.over-blog.com/300x300/1/83/07/63/femmes/images-3-.jpg)
![Weiss,%20alsacienne[1]](http://img.over-blog.com/197x300/1/83/07/63/femmes/Weiss--20alsacienne-1-.jpg)
![Louise Weiss[1]](http://img.over-blog.com/300x218/1/83/07/63/femmes/Louise_Weiss-1-.jpg)
![weiss bertin[1]](http://img.over-blog.com/189x300/1/83/07/63/femmes/weiss_bertin-1-.jpg)
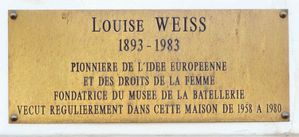




![2a06bca6[1]](http://img.over-blog.com/215x300/1/83/07/63/activites-2013/cartes-noel-nouvel-an/2a06bca6-1-.gif)
![54d7af04[1]](http://img.over-blog.com/198x300/1/83/07/63/activites-2013/cartes-noel-nouvel-an/54d7af04-1-.jpg)
![bd286308[1]](http://img.over-blog.com/300x196/1/83/07/63/activites-2013/cartes-noel-nouvel-an/bd286308-1-.jpg)
![e8ece7c7[1]](http://img.over-blog.com/196x300/1/83/07/63/activites-2013/cartes-noel-nouvel-an/e8ece7c7-1-.jpg)
![1bctu96n[1]](http://img.over-blog.com/100x97/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/1bctu96n-1-.jpg)
![7b893b59[1]](http://img.over-blog.com/300x262/1/83/07/63/activites-2012/porte-bonheur/7b893b59-1-.gif)

![images[3]](http://img.over-blog.com/300x199/1/83/07/63/Industrie-et-commerce/images-3-.jpg)
![images[2]](http://img.over-blog.com/300x197/1/83/07/63/Industrie-et-commerce/images-2-.jpg)
![images[1]](http://img.over-blog.com/300x193/1/83/07/63/Industrie-et-commerce/images-1-.jpg)
![images[10]](http://img.over-blog.com/300x193/1/83/07/63/Industrie-et-commerce/images-10-.jpg)
![bac 2008 p4 27956[1]](http://img.over-blog.com/191x300/1/83/07/63/activites-2011/journee-8-mars/bac_2008_p4_27956-1-.jpg)
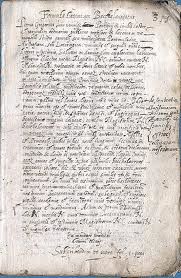
![J.V Daubi%C3%A9[1]](http://img.over-blog.com/202x300/1/83/07/63/femmes/J.V_Daubi-C3-A9-1-.jpg)
![1405-Carte%20ancienne%20je%20fais%20comme%20papa maxi[1]](http://img.over-blog.com/215x300/1/83/07/63/activites-2012/fete-des-peres/1405-Carte-20ancienne-20je-20fais-20comme-20papa_maxi-1-.gif)
